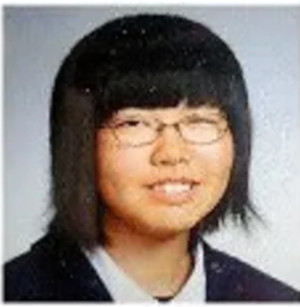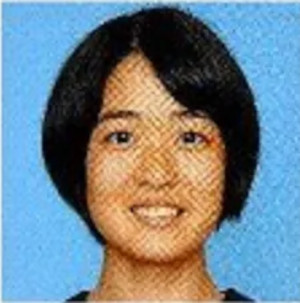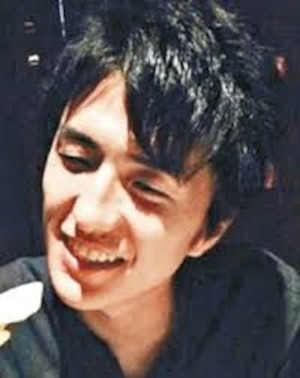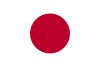Dans la moiteur étouffante de l’été 2017, des disparitions mystérieuses agitent les faubourgs de Tokyo. De jeunes femmes, souvent fragilisées par des pensées suicidaires, cessent brusquement de donner signe de vie après avoir échangé sur les réseaux sociaux. L’inquiétude grandit dans les familles, mais faute de liens apparents entre les victimes, les signalements restent épars, comme noyés dans l’anonymat d’une ville immense.
Tout bascule à la fin du mois d’octobre. Un frère obstiné, inquiet de l’absence de sa sœur Aiko Tamura, retrace méticuleusement ses échanges numériques et parvient à remonter jusqu’à un homme à l’allure banale : Takahiro Shiraishi. C’est dans une ruelle sans éclat de Zama, à une heure de Tokyo, que la police découvre l’horreur. Dans un appartement exigu, à l’odeur suffocante, les enquêteurs tombent sur neuf têtes humaines soigneusement conservées dans des glacières. L’arrestation du « tueur de Twitter » est immédiate. Sous le regard impassible des inspecteurs du Service d’Investigation Criminelle, Shiraishi avoue sans résistance l’ensemble de ses meurtres, révélant un mode opératoire glaçant : il ciblait en ligne des personnes exprimant des idées suicidaires, leur promettant de mourir avec elles ou de les aider à disparaître. L’appartement devient le théâtre d’une fouille méthodique, où chaque boîte, chaque sac dissimule des fragments d’atrocité.
Dans les jours qui suivent, les identités des victimes émergent lentement. Parmi elles : Akari Suda 17 ans, Kureha Ishihara 15 ans, Natsumi Kubo 17 ans, Hinako Sarashina 19 ans, Hitomi Fujima 26 ans, Aiko Tamura 23 ans, Mizuki Miura 21 ans, Kazumi Maruyama 25 ans et Shogo Nishinaka, seul homme du groupe, âgé de 20 ans. Tous avaient été attirés dans cet appartement en quête d’une forme de répit, et tous y ont trouvé la mort.
Shiraishi raconte sans détour comment il isolait ses victimes, les étranglait, puis mutilait leur corps. Selon les experts psychiatres convoqués par l’équipe judiciaire, il ne souffre d’aucune psychose, ni trouble mental majeur. Il agit, dit-il, « pour le plaisir » et pour satisfaire un profond désir de domination.
La société japonaise, choquée, vacille face à l’ampleur du crime. Les médias abordent le sujet avec prudence, souvent retenus par un code de déontologie strict, tandis que les réseaux sociaux deviennent un espace d’effroi et de débat. À Zama, les riverains, bouleversés, voient leur quartier devenir symbole d’un drame national.
Le procès s’ouvre en septembre 2020, dans une salle d’audience pleine à craquer. Les visages des familles, figés par la douleur, croisent celui de l’accusé, imperturbable. Face aux juges, Shiraishi reconnaît froidement les faits. Il affirme n’éprouver aucun regret, ajoutant qu’il n’a « aucun intérêt pour la vie des autres ». La tentative de son avocat d’atténuer sa peine, en évoquant une altération du discernement, est balayée par une analyse médico-légale rigoureuse. Après plusieurs semaines d’audiences éprouvantes, le verdict tombe : peine de mort. Le président du tribunal souligne la cruauté méthodique des crimes, le mépris de la vie humaine, et l’absence totale de repentir. Dans la salle, un silence dense s’installe — un mélange de soulagement et de deuil, figé dans le marbre de la justice.