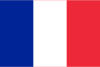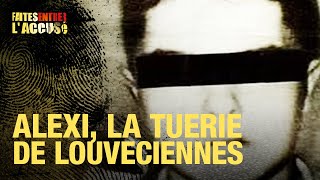Dans la nuit du 26 au 27 février 1995, Alexi Polevoï, un adolescent russe de 16 ans, rentre dans la demeure familiale à Louveciennes, après une soirée passée à Paris, entre bars huppés et prostituée de luxe. Peu après 22 h 30, utilisant trois armes de collection appartenant à son père, il commet une tuerie, tuant six personnes : son père Eugène, riche homme d’affaires russe, sa belle-mère, un couple d’amis et les beaux-parents de son père. Seule sa demi-sœur de deux ans et demi, Nathalie, échappe au massacre, protégée par son sommeil dans sa chambre.
Vers 3 heures du matin, Alexi met en scène une effraction en brisant la porte-fenêtre et appelle la police en prétendant avoir découvert les cadavres à son retour. Rapidement suspecté par les enquêteurs, Alexi avoue dans la journée même, expliquant ce geste par les violences et humiliations répétées infligées par son père, opposé à ses fréquentations amoureuses.
Neuf mois plus tard, le 23 novembre 1995, Alexi se rétracte et évoque une autre version : un mystérieux homme en noir cagoulé, parlant russe, aurait commis les assassinats à la recherche d’un dossier portant l’inscription « 30 millions de dollars ». Selon Alexi, ce tueur l’aurait contraint à tirer sur le corps de son père, puis à appeler la police pour s’accuser du crime.
Malgré les détails troublants fournis par Alexi, les enquêteurs restent sceptiques. La piste mafieuse est rapidement avancée par les avocats de l’adolescent, car Eugène Polevoï avait accumulé sa fortune en Russie, dans un contexte post-soviétique opaque et dangereux, entouré d’anciens du KGB et de soupçons de trafic d’armes.
Le 8 décembre 1996, Dimitri Polevoï, frère d’Eugène qui avait repris la direction de ses entreprises après sa mort, est assassiné en Biélorussie. Ce crime accentue les soupçons concernant l’implication éventuelle de la mafia russe dans la tuerie de Louveciennes, mais la justice française peine à établir des liens concrets.
Le 4 mars 1998, le procès d’Alexi s’ouvre devant la cour d’assises des mineurs des Yvelines. Malgré les nombreuses zones d’ombre et les doutes subsistant autour d’une possible manipulation, la cour condamne Alexi à huit ans de prison le 14 mars 1998, une peine inférieure aux réquisitions initiales qui demandaient entre 18 et 20 ans.
Cette peine modérée souligne les hésitations du jury, pris entre la thèse du parricide et celle d’un règlement de comptes mafieux, jamais clairement établie. Pendant sa détention, Alexi, décrit comme un détenu modèle, bénéficie progressivement de permissions de sortie.
Le 8 juillet 2000, après cinq ans et cinq mois passés en prison, Alexi est libéré sous le régime de la liberté conditionnelle, à l’âge de 21 ans. La justice française lui permet de rester sur le territoire, considérant les risques potentiels de représailles en Russie.
Libéré, Alexi s’installe en région parisienne, accueillie par une amie russe, et retrouve progressivement une vie normale, toujours soutenu par sa mère Raïssa, convaincue de son innocence. L’affaire reste toutefois marquée par des interrogations non résolues et des doutes persistants sur le véritable déroulement de cette sanglante nuit de février 1995.