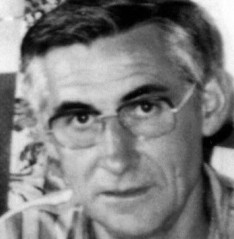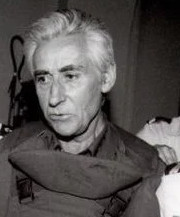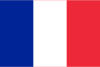Le 20 janvier 1997, une tragédie secoue la petite ville de Saint-Quentin, dans l’Aisne, lorsque les pompiers sont appelés d’urgence au Grand Hôtel, un établissement prestigieux situé rue Dachery. À leur arrivée, ils découvrent les corps sans vie du directeur de l’hôtel, Léo Roupioz, et de sa compagne Gisèle Kunstler, tous deux sauvagement assassinés. Un mot anonyme, trouvé sur les lieux, revendique ces meurtres, plongeant les enquêteurs dans une atmosphère de terreur et de mystère.
Rapidement, les policiers se rendent compte que plusieurs employés de l’hôtel manquent à l’appel, notamment Jean-Baptiste Hennequin, le veilleur de nuit. La situation se complique davantage lorsqu’un incendie d’origine criminelle est signalé dans un studio appartenant à Hennequin, situé rue de l’Est. Les soupçons se concentrent alors sur lui, surtout après la découverte du groom Philippe Bertrand, enfermé au sous-sol de l’hôtel. Bertrand, traumatisé, révèle aux enquêteurs que Hennequin l’a menacé et qu’il a lui-même avoué avoir tué les deux patrons ainsi que Michèle Fabris, la réceptionniste de 25 ans, dont le corps est retrouvé plus tard dans la cave à vin de l’hôtel.
Les autopsies confirment l’horreur des faits : les victimes ont été tuées par balles et achevées à coups de hachette. L’enquête montre que Hennequin, un homme au passé trouble, nourrissait une haine profonde envers ses supérieurs et en particulier envers Gisèle Kunstler et Michèle Fabris, qu’il accusait de le trahir.
Le 29 janvier 1997, la voiture de Michèle Fabris, volée par Hennequin, est retrouvée à Amiens, mais le meurtrier reste introuvable. Un mandat d’arrêt international est lancé, mais ce n’est que le 22 mai 1997 que la cavale de Hennequin prend fin. Il est arrêté dans un hôtel parisien sous une fausse identité, après que les policiers y découvrent des articles de presse relatant le triple meurtre du Grand Hôtel.
Le procès de Jean-Baptiste Hennequin s’ouvre le 17 juin 1999 à Laon. L’accusé, décrit comme un homme solitaire et paranoïaque, refuse d’évoquer son passé difficile. Lors de son témoignage, il relate froidement les détails des meurtres, expliquant qu’il a agi par vengeance, se sentant incompris et persécuté. Il affirme que sa haine des patrons et son sentiment d’injustice l’ont poussé à commettre ces actes atroces.
Finalement, Hennequin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, la peine maximale requise par l’avocat général.