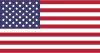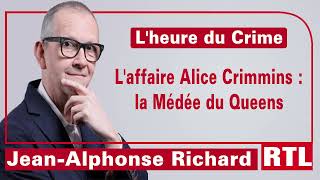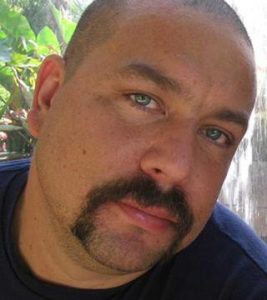Tout débute un matin étouffant de juillet 1965, dans le quartier modeste de Queens, à New York. Alice Crimmins, jeune mère séparée, signale à la police la disparition de ses deux enfants, Eddie Jr., cinq ans, et Alice Marie, surnommée « Missy », âgée de quatre ans. Les voisins décrivent une agitation inhabituelle autour de l’immeuble tandis que les premières recherches s’organisent dans une chaleur écrasante.
Quelques heures plus tard, le petit corps sans vie d’Alice Marie est retrouvé, dissimulé sous un buisson non loin du domicile familial. L’émotion gagne les rues ; les enquêteurs du NYPD redoublent d’efforts, conscients que chaque minute compte pour espérer retrouver Eddie Jr. vivant. Pourtant, deux jours plus tard, c’est un second drame : le garçon est découvert mort dans un terrain vague.
Rapidement, le comportement d’Alice Crimmins intrigue. Observée scrupuleusement par la brigade criminelle, elle affiche une froideur jugée suspecte par les agents et la presse locale, avide de détails. Sa vie privée, marquée par des fréquentations masculines et des soirées arrosées, devient un élément central de l’enquête. Malgré l’absence de preuves matérielles directes, les soupçons convergent. Durant de longs mois, les policiers surveillent, enregistrent et interrogent sans relâche. En 1968, soit trois ans après les faits, l’affaire rebondit : Alice est finalement arrêtée, accusée du meurtre de sa fille sur la base d’indices circonstanciels soigneusement accumulés.
Le procès, ouvert en 1968, captive l’opinion publique. Les témoignages se succèdent, certains anciens amants dépeignant une femme « insouciante », tandis que la défense plaide l’absence de lien direct entre Alice et les décès. La salle d’audience, tendue, oscille entre indignation et fascination devant la figure ambivalente de l’accusée. En 1968, le jury la déclare coupable du meurtre de Missy. La condamnation provoque des débats animés sur la fragilité des preuves et la moralité présumée d’une mère célibataire. Cependant, en appel, le verdict est annulé, dénonçant des erreurs de procédure liées à la règle de preuve.
Un second procès s’ouvre en 1971. Cette fois, Alice Crimmins est reconnue coupable d’homicide involontaire pour la mort d’Eddie Jr., une accusation moins lourde mais tout aussi dévastatrice. Le juge la condamne à une peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement.
Après avoir purgé plusieurs années derrière les barreaux, elle est libérée sur parole en 1977. Installée sous un autre nom, elle choisit l’anonymat pour échapper à l’attention publique. À ce jour, de nombreuses zones d’ombre persistent autour de l’affaire, laissant planer un doute lancinant sur l’ampleur exacte de sa culpabilité.