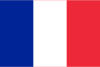Dans la nuit du 31 juillet 1991, à Clairac, dans le Lot-et-Garonne, Caroline Nolibé, 18 ans, est retrouvée ensanglantée dans la cour de la maison familiale. Son père, Claude Nolibé, découvre le corps sans vie de sa fille et, en état de choc, ne parvient pas à expliquer la scène aux secours. Très vite, les soupçons se portent sur lui. L’homme est arrêté, placé en garde à vue puis mis en examen pour assassinat.
Le 14 août 1991, il est incarcéré à la maison d’arrêt d’Agen et passe 45 jours en détention provisoire. Les enquêteurs et le procureur de Marmande semblent convaincus de sa culpabilité, bien que les preuves manquent. En 1997, après six années d’instruction et en l’absence de charges probantes, Claude Nolibé bénéficie d’un non-lieu. Mais cette décision ne suffit pas à effacer les stigmates d’une accusation infondée.
Pendant dix ans, l’enquête reste au point mort. C’est en 2001 qu’un élément décisif relance l’affaire : une lettre est découverte sous un lit dans un institut médico-social de Clairac. L’auteur de cette missive, Philippe Guendouze, pensionnaire déficient mental, y avoue avoir tué Caroline Nolibé. Ce dernier est interpellé et placé en garde à vue. Lors des interrogatoires, il reconnaît les faits avec précision avant de se rétracter subitement.
L’enquête met également en lumière une autre agression commise par Guendouze en 1985 sur une jeune fille de Sainte-Livrade. Malgré cette révélation, la question de sa responsabilité pénale divise les experts psychiatres, qui oscillent entre l’hypothèse du déni et celle d’une stratégie de défense.
En 2004, Philippe Guendouze est jugé devant la cour d’assises d’Agen. L’accusé, décrit comme ayant l’âge mental d’un enfant, se montre confus et imprécis sur les faits. Sa famille, tout comme son avocate, insiste sur sa vulnérabilité et son incapacité à préméditer un tel acte. Pourtant, la justice considère ses aveux ainsi que les éléments de l’enquête comme suffisamment probants. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
De son côté, Claude Nolibé reste marqué par une décennie d’accusations injustes. En novembre 2010, la commission régionale d’indemnisation de la détention provisoire reconnaît officiellement l’erreur judiciaire et lui accorde une indemnisation de 50 000 euros. Ce montant, bien que symbolique, ne compense en rien les années d’humiliation et de souffrance endurées. Il a vécu comme un paria, traité d’assassin par sa propre communauté, et privé du deuil légitime de sa fille.